Tout être vivant est construit
selon un plan construit dans ses cellules, au niveau de ses chromosomes, sous la
forme de séquences de base azotées le long de la molécule d'A.D.N. (acide
désoxyribonucléique) qui les compose. Toute modification de cette séquence
entraîne une modification de la structure, de la physiologie et du comportement
de l'individu. Il est, de ce fait, indispensable, pour conserver les
caractéristiques de l'espèce, que la molécule d'A.D.N. reste immuable. Mais les
conditions de vie ont changé au cours des temps géologiques, ce qui a nécessité
une évolution des diverses espèces. Cette évolution n'est rendue possible que
par une modification continuelle de la structure des êtres vivants, c'est-à-dire
de la structure de l'A.D.N. Nous nous trouvons en face d'un double problème,
l'immuabilité de la molécule d'A.D.N., d'une part, et son évolution d'autre
part.
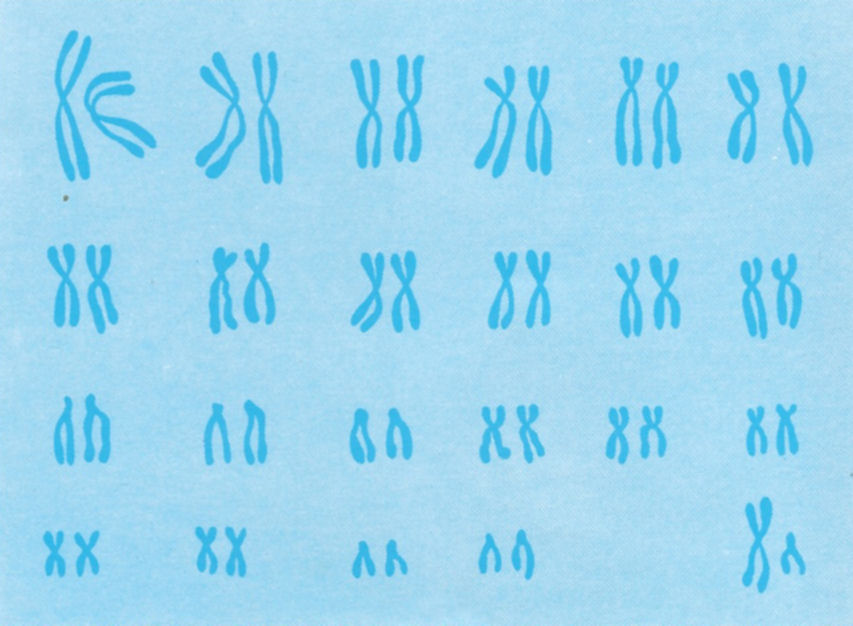 Garniture chromosomique d'une cellule masculine : on
distingue sur le schéma les 22 paires d'autosomes (chromosomes
quelconques et, en bas à droite, la paire d'allosomes (chromosomes
sexuels) dont les deux éléments présentent des formes distinctes.
Garniture chromosomique d'une cellule masculine : on
distingue sur le schéma les 22 paires d'autosomes (chromosomes
quelconques et, en bas à droite, la paire d'allosomes (chromosomes
sexuels) dont les deux éléments présentent des formes distinctes.
La solution se trouve dans l'échange de ces molécules
d'A.D.N. entre deux individus de la même espèce, afin de permettre l'échange des
caractères héréditaires éventuellement nouveaux qui apparaissent par le
mécanisme des mutations, tout en empêchant des modifications radicales qui
feraient disparaître l'espèce. Cet échange entre le matériel génétique de deux
individus correspond à la reproduction sexuée.
Chez les êtres vivants pluricellulaires, animaux ou végétaux,
la reproduction sexuée correspond à la fusion de deux types de cellules issues
de deux lignées différentes, mâle et femelle (gamètes), et qui forment un œuf
dont le développement aboutira à la constitution d'un nouvel individu. Les
cellules somatiques étant généralement diploïdes (2 chromosomes de
chaque type), la formation de ces cellules reproductrices nécessite une
réduction chromatique, qui devrait les rendre haploïdes (composées de 1
chromosome de chaque type).
La cellule mâle, ou spermatozoïde, se distingue
morphologiquement et génétiquement de la cellule femelle ou ovule. Le
spermatozoïde est petit, très mobile et dépourvu de réserves. L'ovule, au
contraire, est pratiquement immobile, et son cytoplasme renferme les réserves
nécessaires au développement de l'embryon. La différence entre les deux sexes
donnant naissance à ces deux types de cellules s'observe également au niveau des
organes génitaux qui distinguent les individus mâles des individus femelles.
Cette distinction, basée sur les caractères sexuels primaires (appareil
reproducteur et annexes), est accentuée par l'existence de caractères sexuels
secondaires tels que la taille, la pilosité, le timbre de la voix, la présence
de cornes, de plumes colorées, etc.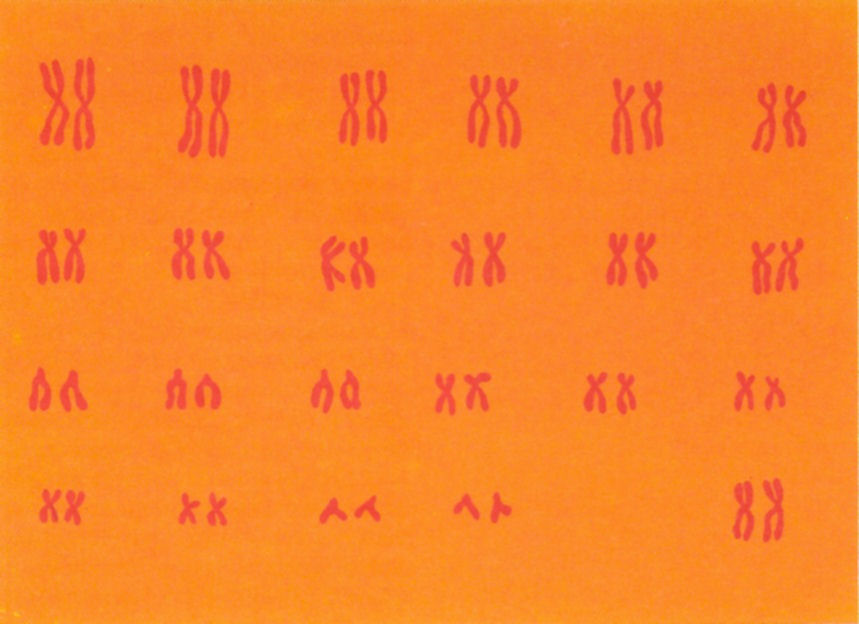
Garniture chromosomique d'une cellule
féminine. Les chromosomes sexuels de la femme sont identiques (X et X).
Chez la plupart des espèces, la détermination du sexe est
basée sur la présence de chromosomes sexuels ou hétérochromosomes qui, chez
l'homme, sont les chromosomes X et Y. Nous possédons 23 paires de chromosomes
(autosomes) et une paire de chromosomes sexuels qui sont appelés XX chez la
femelle et qui sont identiques l'un à l'autre, et XY, parce que différents, chez
le mâle. Cette différence d'ordre génétique détermine, au cours du développement
de l'individu, l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires.
Au moment de la formation des gamètes, par réduction
chromatique, chaque cellule ne renfermera plus qu'un seul chromosome de chaque
paire. Les ovules renfermeront tous un chromosome X, alors que nous aurons deux
types de spermatozoïdes, l'un comportant un chromosome X, l'autre un chromosome
Y. Ce dimorphisme chromosomique a pour conséquence de maintenir une proportion à
peu près équivalente à 50% de chaque sexe dans une population donnée.
Le principe de la reproduction sexuée permet l'évolution de
l'espèce par le polymorphisme des individus, tout en maintenant une certaine
stabilité pour le brassage des caractères. Il s'observe déjà chez les êtres
vivants primitifs tels que les virus et les bactéries, même s'il n'y a pas de
dimorphisme sexuel apparent. Ces chez micro-organismes on parle de
"para-sexualité", car il existe une recombinaison génétique sans qu'il soit
nécessaire de passer par une réduction chromatique.
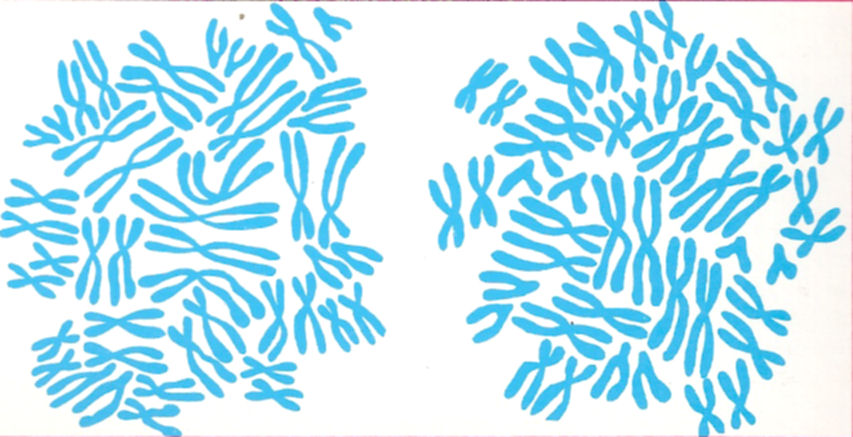 Garnitures chromosomiques d'un homme (à gauche) et d'une
femme (à droite) telles qu'elles apparaissent dans les préparations observées au
microscope. Les chromosomes sont surtout visibles au moment de la division
cellulaire.
Garnitures chromosomiques d'un homme (à gauche) et d'une
femme (à droite) telles qu'elles apparaissent dans les préparations observées au
microscope. Les chromosomes sont surtout visibles au moment de la division
cellulaire.
Le virus se présente sous la forme d'une molécule d'A.D.N. ou
dans certains cas d'A.R.N. (virus de la mosaïque du tabac) entourée d'une
enveloppe protectrice. Le virus, se fixant sur une bactérie, injecte sa molécule
génétique dans celle-ci. Cette molécule, en se multipliant, effectue des
recombinaisons avec les molécules d'autres virus, et reforme de nouveaux
individus qui iront infester d'autres bactéries. Chez certains protozoaires, on
trouve deux noyaux dont l'un est destiné à la régulation des mécanismes
cellulaires, alors que l'autre n'intervient que dans la reproduction. Chez les
multicellulaires, apparaissent des cellules reproductrices spécialisées.
Habituellement, le sexe génital d'un individu coïncide avec
son sexe génétique. Il faut cependant signaler l'existence d'inversions
sexuelles partielles ou totales, car le déterminisme du sexe génital est sous
l'influence de sécrétions hormonales des gonades ou d'autres glandes endocrines,
comme les surrénales. Certaines espèces sont hermaphrodites, c'est-à-dire à la
fois mâle et femelle. Lorsque les sexes sont nettement séparés, les caractères
sexuels primaires apparaissent au cours du développement embryonnaire.
Après la naissance, on observe une période plus ou moins
longue où, apparemment, il ne se passe rien sur le plan sexuel; en fait, du
point de vue comportemental, il s'agit de la phase la plus importante.
Les caractères sexuels se développent, quant à eux, au moment
de la puberté, chez l'homme, ou de la maturation sexuelle, chez les animaux, en
même temps que se manifestent les premiers comportements liés à la reproduction.
Le développement des caractères sexuels secondaires peut être modifié par la
castration ou l'administration d'hormones. Il est possible d'obtenir une
inversion totale du sexe chez les insectes, une gonade de chaque type chez les
oiseaux ou un pseudo-hermaphrodisme chez les mammifères. Chez ces derniers,
l'inversion ne se situe qu'au niveau des organes génitaux externes, jamais au
niveau des gonades. La castration d'un jeune coq empêche le développement de la
crête, effet qui peut être compensé par l'injection d'hormones mâles.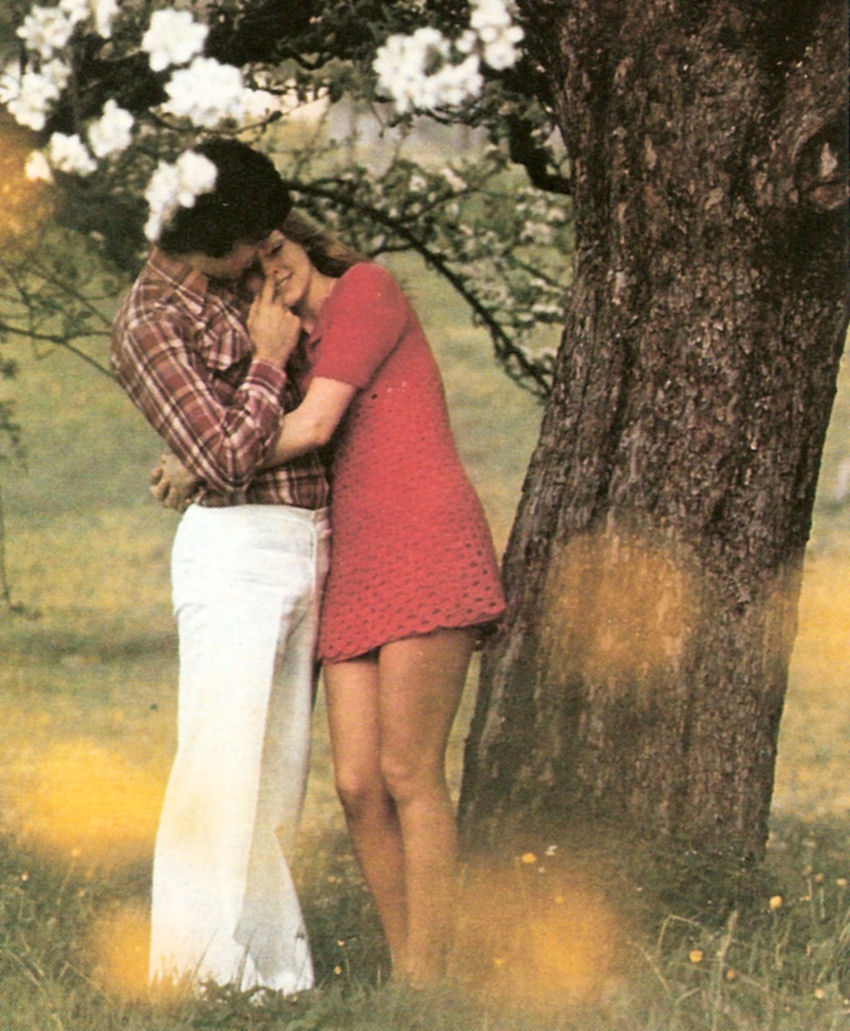
Le bonheur et l'équilibre des couples se
ressentent profondément de la réussite de leur vie sexuelle. Des organismes
comme le planning familial ont été créés pour informer et guider en matière
d'éducation sexuelle, de contrôle des naissances et de lutte contre la
stérilité.
Les hormones sexuelles jouent un rôle important chez
l'adulte, notamment en modifiant le tractus génital au cours du cycle ovarien
chez la femelle. L'œstradiol (hormone femelle) développe le tractus génital, les
glandes mammaires, et modifie le comportement de l'individu. La progestérone
agit pendant la deuxième phase du cycle, en favorisant la prolifération de la
muqueuse utérine et l'implantation de l'œuf. Le cycle ne peut se dérouler
normalement que s'il y a une harmonie fonctionnelle entre ces deux hormones dont
la sécrétion est sous la dépendance de facteurs hypophysaires. Il en est de même
pour les hormones mâles.
Si la période entre la naissance et la puberté semble peu
importante sur le plan de l'anatomie et de la physiologie sexuelle, il n'en va
pas de même pour le comportement. Konrad Lorenz a ainsi observé des
modifications dans le comportement des oies lorsqu'elles sont élevées par
l'homme. Quand la jeune oie sort de l'œuf, elle reçoit une "empreinte", sorte de
"fixation psychique sur le premier objet mobile qui apparaît dans son champ
visuel, et qui est normalement sa mère. Ce phénomène n'a apparemment aucune
relation avec le comportement reproducteur. Mais Lorenz est parvenu à remplacer
la mère auprès de jeunes oies dès la naissance. Or, il se trouve qu'arrivées à
l'âge adulte, les oies mâles essayèrent de prendre Lorenz comme partenaire
sexuel !
Le phénomène d'empreinte, qui apparaît dès l'éclosion, avant
même que ne se manifeste le moindre comportement sexuel, est donc en mesure de
déterminer celui-ci chez l'animal adulte. Le même phénomène s'observe chez les
canards. Le jeune caneton aperçoit normalement comme premier objet mobile sa
mère; si on la remplace par un canard mâle adulte, les jeunes canetons
présenteront un comportement homosexuel lorsqu'ils seront en âge de se
reproduire et choisiront les mâles de leur espèce comme partenaire sexuel.
Le comportement reproducteur d'un animal est génétiquement
déterminé, mais il est possible de le dévier, comme le montrent les expériences
effectuées sur le rat. Si l'on injecte de l'hormone mâle à une jeune rate
pendant les trois premiers jours suivant sa naissance, elle manifestera à l'état
adulte un comportement de mâle, tout en étant morphologiquement,
physiologiquement et génétiquement une femelle. Ces quelques observations
montrent de la période "silencieuse" séparant la maturité sexuelle de la
naissance n'est pas insensible à diverses stimulations, qui peuvent modifier le
comportement reproducteur ultérieur d'une espèce.
On a remarqué que chez plusieurs espèces, les jeux
apparemment innocents des jeunes permettent l'établissement du comportement
sexuel adulte. Lors de l'accouplement, le putois mâle saisit la femelle à la
nuque pour l'immobiliser. Des jeunes putois élevés isolément et n'ayant pas pu,
de ce fait, jouer avec leurs congénères, ne connaissent pas cette prise. Le
macaque mâle saisit les mollets de la femelles à l'aide de ses pattes
postérieures lors de l'accouplement.
Cette posture très stéréotypée est inconnue des macaques qui
n'ont pas eu la possibilité de jouer avec des congénères lors de leur jeune âge.
Secondairement, l'accouplement acquiert une signification de relation sociale
indépendante de l'acte de procréation.
L'action des hormones sur le comportement reproducteur et
l'importance du jeu montrent qu'un certain nombre de circuits nerveux se mettent
en place pendant la période séparant la naissance de la maturité sexuelle bien
avant que ne se manifeste le comportement reproducteur d'adulte.
C'est à Sigmund Freud (1856-1939) que revient le mérite
d'avoir souligné l'importance de la sexualité infantile du point de vue
psychique. Dans Trois Essais sur la théorie de la sexualité, il montre
que la sexualité de l'adulte est conditionnée par des événements de son enfance.
L'un des premiers, aussi, il voit aux troubles de la sexualité une origine
psychologique.
Cependant, l'hypothèse de Freud selon laquelle l'instinct
sexuel, qu'il désigne du terme de libido, serait la seule force motrice
de l'individu, est rejetée par la psychanalyse moderne.
![]()