Le soleil
 Le
disque solaire et ses taches tel qu'il apparaît, observé au télescope. Les
taches sont des phénomènes temporaires dont la durée varie de quelques jours
à quelques semaines. A plus de 149 millions de kilomètres de la
Terre, distance que la lumière elle-même met 8 minutes à franchir, se trouve
notre étoile, le Soleil. Depuis environ 5 milliards d'années, car tel serait
son âge d'après les estimations les plus récentes, cet astre brille sans
changements appréciables, sauf ceux qui eurent lieu au début de son
évolution. Son diamètre est de 1 392 000 km, et son volume vaut 1 303 800
fois celui de la Terre. Mais, étant donné que le Soleil es composé de
matériaux plus légers que ceux qui constituent notre planète, sa masse
équivaut "seulement" à 332 946 fois celle du globe terrestre;à sa surface,
la pesanteur est 28 fois plus élevée que la nôtre, c'est-à-dire qu'un homme
adulte y pèserait environ deux tonnes. Grâce à l'astrophysique et à la
spectroscopie, on a pu étudier la composition du Soleil, le considérant
comme une sphère de gaz incandescents. A la surface visible de l'astre,
celle que l'on discerne à l'il nu ou au télescope (la photosphère),règne
une chaleur intense: environ 6 700°C. Plus on pénètre à l'intérieur de cet
astre ardent, plus la température et la pression augmentent : on a calculé
que, dans le noyau solaire, doit régner une température de 14 millions de
degrés centigrades. On sait aujourd'hui que, au cur de l'astre, des atomes
d'hydrogène se fondent ensemble continuellement, produisant des atomes
d'hélium. Lors du processus, une partie de la masse de matière existante
subit une transformation en énergie pure : ce qui se produit dans les
profondeurs solaires est tout à fait semblable aux réactions énergétiques
mises en oeuvre dans une bombe à hydrogène. Toutefois, la violence de la
réaction est contenue par les quantités gigantesques de gaz comprimé se
trouvant autour du noyau. En transformant l'hydrogène en hélium, le Soleil
perd 4 millions de tonnes de matière par seconde, intégralement transformées
en radiations; mais l'astre est tellement massif que, au rythme actuel des
pertes, il continuera de briller pendant au moins 6 milliards d'années.
L'énergie produite dans le noyau revêt la forme de rayons gamma : si ceux-ci
se répandaient directement dans l'espace, toute trace de vie disparaîtrait
de la Terre. Heureusement, en remontant du noyau vers la surface du Soleil,
ces rayons gamma sont dégradés dans les immenses couches de gaz, perdant
lentement leur énergie; ils sont progressivement transformés en rayons X et
en rayons ultraviolets, dans une grande enveloppe interne où le noyau répand
encore de l'énergie par rayonnement. Plus à l'extérieur, il existe une
enveloppe où des courants chauds montent jusqu'à la photosphère. Depuis
cette surface, l'énergie est rayonnée dans l'espace sous une forme très
atténuée; malgré cela, ces radiations stériliseraient notre globe si
celui-ci n'était protégé par son atmosphère. Pour observer le Soleil aux
instruments, il faut être très prudent, car il y a risque pour la vue, même
si l'on utilise des filtres de verre fumé. La seule façon correcte
d'effectuer de telles observations est de projeter l'image du Soleil sur un
écran blanc, en utilisant le télescope ou la lunette comme projecteur de
diapositives. On observe ainsi des granulosités sur la photosphère, les
"grains de riz" produits par les sommets des courants de gaz très chauds qui
montent des profondeurs, et des trouées sombres qui semblent rompre
momentanément le délicat tissu des granules : ce sont les taches. Bien
qu'elles soient en fait plus brillantes qu'une lampe à arc, elles semblent
presque noires sur l'image, car leur température est beaucoup plus faible
que celle de la photosphère alentour (l'écart est d'environ 2000°C).De plus,
leur niveau se situe 800 à 10 000 km au-dessous de celui de la surface
moyenne. Selon la plupart des astronomes, les taches ont la forme de
cratères, avec une partie centrale plus basse et plus sombre appelée "ombre"
et une partie périphérique filamenteuse plus claire, la "pénombre". Selon
les idées actuelles, les taches du Soleil sont dues aux altérations
produites dans la distribution des gaz photo sphériques par les lignes de
force de gigantesques champs magnétiques qui
Le
disque solaire et ses taches tel qu'il apparaît, observé au télescope. Les
taches sont des phénomènes temporaires dont la durée varie de quelques jours
à quelques semaines. A plus de 149 millions de kilomètres de la
Terre, distance que la lumière elle-même met 8 minutes à franchir, se trouve
notre étoile, le Soleil. Depuis environ 5 milliards d'années, car tel serait
son âge d'après les estimations les plus récentes, cet astre brille sans
changements appréciables, sauf ceux qui eurent lieu au début de son
évolution. Son diamètre est de 1 392 000 km, et son volume vaut 1 303 800
fois celui de la Terre. Mais, étant donné que le Soleil es composé de
matériaux plus légers que ceux qui constituent notre planète, sa masse
équivaut "seulement" à 332 946 fois celle du globe terrestre;à sa surface,
la pesanteur est 28 fois plus élevée que la nôtre, c'est-à-dire qu'un homme
adulte y pèserait environ deux tonnes. Grâce à l'astrophysique et à la
spectroscopie, on a pu étudier la composition du Soleil, le considérant
comme une sphère de gaz incandescents. A la surface visible de l'astre,
celle que l'on discerne à l'il nu ou au télescope (la photosphère),règne
une chaleur intense: environ 6 700°C. Plus on pénètre à l'intérieur de cet
astre ardent, plus la température et la pression augmentent : on a calculé
que, dans le noyau solaire, doit régner une température de 14 millions de
degrés centigrades. On sait aujourd'hui que, au cur de l'astre, des atomes
d'hydrogène se fondent ensemble continuellement, produisant des atomes
d'hélium. Lors du processus, une partie de la masse de matière existante
subit une transformation en énergie pure : ce qui se produit dans les
profondeurs solaires est tout à fait semblable aux réactions énergétiques
mises en oeuvre dans une bombe à hydrogène. Toutefois, la violence de la
réaction est contenue par les quantités gigantesques de gaz comprimé se
trouvant autour du noyau. En transformant l'hydrogène en hélium, le Soleil
perd 4 millions de tonnes de matière par seconde, intégralement transformées
en radiations; mais l'astre est tellement massif que, au rythme actuel des
pertes, il continuera de briller pendant au moins 6 milliards d'années.
L'énergie produite dans le noyau revêt la forme de rayons gamma : si ceux-ci
se répandaient directement dans l'espace, toute trace de vie disparaîtrait
de la Terre. Heureusement, en remontant du noyau vers la surface du Soleil,
ces rayons gamma sont dégradés dans les immenses couches de gaz, perdant
lentement leur énergie; ils sont progressivement transformés en rayons X et
en rayons ultraviolets, dans une grande enveloppe interne où le noyau répand
encore de l'énergie par rayonnement. Plus à l'extérieur, il existe une
enveloppe où des courants chauds montent jusqu'à la photosphère. Depuis
cette surface, l'énergie est rayonnée dans l'espace sous une forme très
atténuée; malgré cela, ces radiations stériliseraient notre globe si
celui-ci n'était protégé par son atmosphère. Pour observer le Soleil aux
instruments, il faut être très prudent, car il y a risque pour la vue, même
si l'on utilise des filtres de verre fumé. La seule façon correcte
d'effectuer de telles observations est de projeter l'image du Soleil sur un
écran blanc, en utilisant le télescope ou la lunette comme projecteur de
diapositives. On observe ainsi des granulosités sur la photosphère, les
"grains de riz" produits par les sommets des courants de gaz très chauds qui
montent des profondeurs, et des trouées sombres qui semblent rompre
momentanément le délicat tissu des granules : ce sont les taches. Bien
qu'elles soient en fait plus brillantes qu'une lampe à arc, elles semblent
presque noires sur l'image, car leur température est beaucoup plus faible
que celle de la photosphère alentour (l'écart est d'environ 2000°C).De plus,
leur niveau se situe 800 à 10 000 km au-dessous de celui de la surface
moyenne. Selon la plupart des astronomes, les taches ont la forme de
cratères, avec une partie centrale plus basse et plus sombre appelée "ombre"
et une partie périphérique filamenteuse plus claire, la "pénombre". Selon
les idées actuelles, les taches du Soleil sont dues aux altérations
produites dans la distribution des gaz photo sphériques par les lignes de
force de gigantesques champs magnétiques qui 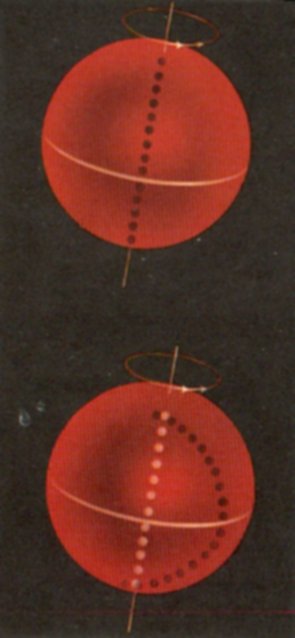 existent à l'intérieur de l'étoile. Les dimensions des groupes peuvent être
parfois énormes : on observé des groupes de taches s'étendant sur 300 000
km, presque la distance de la Terre à la Lune! Leur observation a permis de
mesurer la période de rotation du Soleil, et l'on a ainsi trouvé que la
grande sphère ne tourne pas à une vitesse uniforme. Sa durée de rotation est
de 25,4 jours à l'équateur, et elle augmente en allant vers les pôles, pour
atteindre plus de 30 jours aux latitudes les plus élevées. Pour une raison
encore mal connue, les taches solaires passent d'un nombre maximal à un
nombre minimal tous les 11 ans;ce cycle, dit un décennal, fait lui-même
partie d'un cycle d'une durée de 22 années, au cours duquel le magnétisme
solaire inverse totalement sa polarité. La rotation ne
s'effectue pas d'une façon uniforme en tous les points de la sphère solaire:
elle est plus rapide à l'équateur et plus lente aux pôles. Au-dessus
de la photosphère, s'étend une enveloppe de gaz plus ténus qui irradient une
lumière rouge rosée : c'est la chromosphère, constituée
principalement d'hydrogène et d'hélium. Elle est moins lumineuse que la
photosphère, et est totalement transparente : notre oeil ne peut donc la
percevoir que durant les courts instants des éclipses totales de Soleil. De
la chromosphère jaillissent de gigantesques "flammes" de gaz incandescents
(surtout de l'hydrogène) : ce sont les protubérances, en forme de panaches,
de ramifications, de cumulus, expulsées à une vitesse de plusieurs centaines
de kilomètres par seconde. Quant le Soleil est éclipsé, on peut les voir
directement à l'il nu ou avec une longue-vue, pareilles à des fontaines de
pourpre pétrifiées. En dehors des protubérances, il se produit sur le Soleil
des éruptions d'hydrogène sous forme d'explosions d'intensité inimaginable :
ce sont les éruptions chromo sphériques (en
existent à l'intérieur de l'étoile. Les dimensions des groupes peuvent être
parfois énormes : on observé des groupes de taches s'étendant sur 300 000
km, presque la distance de la Terre à la Lune! Leur observation a permis de
mesurer la période de rotation du Soleil, et l'on a ainsi trouvé que la
grande sphère ne tourne pas à une vitesse uniforme. Sa durée de rotation est
de 25,4 jours à l'équateur, et elle augmente en allant vers les pôles, pour
atteindre plus de 30 jours aux latitudes les plus élevées. Pour une raison
encore mal connue, les taches solaires passent d'un nombre maximal à un
nombre minimal tous les 11 ans;ce cycle, dit un décennal, fait lui-même
partie d'un cycle d'une durée de 22 années, au cours duquel le magnétisme
solaire inverse totalement sa polarité. La rotation ne
s'effectue pas d'une façon uniforme en tous les points de la sphère solaire:
elle est plus rapide à l'équateur et plus lente aux pôles. Au-dessus
de la photosphère, s'étend une enveloppe de gaz plus ténus qui irradient une
lumière rouge rosée : c'est la chromosphère, constituée
principalement d'hydrogène et d'hélium. Elle est moins lumineuse que la
photosphère, et est totalement transparente : notre oeil ne peut donc la
percevoir que durant les courts instants des éclipses totales de Soleil. De
la chromosphère jaillissent de gigantesques "flammes" de gaz incandescents
(surtout de l'hydrogène) : ce sont les protubérances, en forme de panaches,
de ramifications, de cumulus, expulsées à une vitesse de plusieurs centaines
de kilomètres par seconde. Quant le Soleil est éclipsé, on peut les voir
directement à l'il nu ou avec une longue-vue, pareilles à des fontaines de
pourpre pétrifiées. En dehors des protubérances, il se produit sur le Soleil
des éruptions d'hydrogène sous forme d'explosions d'intensité inimaginable :
ce sont les éruptions chromo sphériques (en  anglais flares).Elles apparaissent de façon imprévue sur plusieurs
millions de kilomètres carrés, et disparaissent après un laps de temps de
quelques minutes à plusieurs jours; de leur sein se déchaînent des flux de
radiations à ondes courtes et de particules chargées électriquement.
Le Soleil contient un noyau central dont la température est voisine de 14
millions de degrés;là ont lieu des transformations nucléaires libérant
l'énergie projetée à l'extérieur après avoir traversé les couches
intermédiaires. Jaillie de la chromosphère, la flamme d'une protubérance
D'autre part, le Soleil émet de façon continue un flux de particules, appelé
vent solaire, qui "repousse" les queues des comètes en les faisant s'étendre
dans l'espace. Une partie de la masse solaire est ainsi continuellement
dispersée, avec les radiations, mais elle est vraiment infinitésimale par
rapport à la masse totale de l'astre. Une grande quantité de particules
libres entoure en permanence le Soleil, s'éloignant insensiblement dans
l'espace et formant l'enveloppe la plus extérieure, appelée couronne.
Cette zone est une radio-source intense, ce qui fait que la radio-astronomie
a beaucoup contribué à sa connaissance.
anglais flares).Elles apparaissent de façon imprévue sur plusieurs
millions de kilomètres carrés, et disparaissent après un laps de temps de
quelques minutes à plusieurs jours; de leur sein se déchaînent des flux de
radiations à ondes courtes et de particules chargées électriquement.
Le Soleil contient un noyau central dont la température est voisine de 14
millions de degrés;là ont lieu des transformations nucléaires libérant
l'énergie projetée à l'extérieur après avoir traversé les couches
intermédiaires. Jaillie de la chromosphère, la flamme d'une protubérance
D'autre part, le Soleil émet de façon continue un flux de particules, appelé
vent solaire, qui "repousse" les queues des comètes en les faisant s'étendre
dans l'espace. Une partie de la masse solaire est ainsi continuellement
dispersée, avec les radiations, mais elle est vraiment infinitésimale par
rapport à la masse totale de l'astre. Une grande quantité de particules
libres entoure en permanence le Soleil, s'éloignant insensiblement dans
l'espace et formant l'enveloppe la plus extérieure, appelée couronne.
Cette zone est une radio-source intense, ce qui fait que la radio-astronomie
a beaucoup contribué à sa connaissance.