Page 1
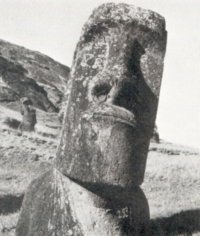 1722, un dimanche de Pâques, Roggeveen, navigateur hollandais commandant
l'Arena, découvre une île qu'il prit d'abord pour l'île Davis. A mesure
qu'il s'approchait du rivage, il s'aperçut que ce n'était pas l'île décrite
par Davis, car celle ci était habitée. Le contact entre les Pascuans et les
Hollandais eut lieu le lendemain. Un Pascuan venu à la nage, monta à bord,
l'indigène non étonné se montrait curieux, il se promenait sur le pont
contemplait les mats et les canons. Il repartit à la nage comblé de
présents. Le lendemain ils revinrent en nombre sur le navire qu'ils
dévalisèrent. Après ce chapardage, ils repartirent suivis par les
Hollandais. Soudain un ordre cingla "faites feu maintenant" les mousquets
crépitèrent laissant au sol de nombreux Pascuans. Les indigènes s'enfuirent,
les Hollandais rejoignirent leur navire en ayant toutefois aperçu de loin
des monuments étranges. Vue leur taille, ils pensèrent qu'ils étaient en
argile. Pendant cinquante ans cette île fut oubliée. C'est Felipe
Gonzalez y Haedo qui la visita pour la seconde fois en 1770. L'île fut
annexée au royaume espagnol sous le nom de San Carlos. Quatre ans plus tard,
elle reçoit la visite du capitaine Cook. La réception fut identique aux
précédentes visites. C'est grâce au capitaine Cook que l'île a gardé la
renommée qu'elle a encore aujourd'hui, l'explorateur ayant décrit les
statues géantes lors de son voyage. Deux ans plus tard en 1786, le comte de
La Pérouse commandant une expédition française, débarque sur l'île de
Paques. En 1808 un bateau américain mouille au large de l'île de Paques, là
c'est un massacre, les corps jonchent le sol, avant de partir ils enlèvent
douze hommes et dix femmes qu'ils mettent à fond de cale. Arrivés en pleine
mer ils les délivrent. Libres sur le pont du bateau ils sautent tous à l'eau
et nagent pour rejoindre la côte. Les soldats américains essaieront bien de
les reprendre, mais chaque fois qu'ils s'approchaient d'eux ils plongeaient
et disparaissaient. On ne sait s'ils parvinrent à rejoindre le rivage. En
1816 l'île reçut la visite d'un navire russe commandé par le navigateur
Kotzebue. 1838 l'amiral du Petit Thouars mouille au large de l'île. L'année
1862 vit la fin de la civilisation de l'île de Pâques grâce aux négriers
péruviens. C'est l'intervention de Monseigneur Jaussen, qui en 1914 décida
le gouvernement français et l'Angleterre à agir. Sous la pression les
Péruviens relâchèrent les Pascuans qu'ils détenaient pour le ramassage du
Guano, mais il était trop tard. Tous malades atteints de la tuberculose et
de la petite vérole. Seulement une vingtaine parvint sur l'île les autres
étant morts pendant le voyage sur le bateau. L'épidémie gagna les autres
Pascuans restés sur l'île, ainsi disparut la civilisation de l'île de
Pâques. Si l'île de Paques est souvent décrite comme une île désertique,
rocailleuse, volcanique il n'en a pas été toujours ainsi. Roggeveen lui
donna le nom de "paradis terrestre" et La Pérouse fut enchanté par la nature
du site. Les versants des volcans furent et sont encore tapissés de prairies
verdoyantes, les rivages formés de jardins et de bananeraies. Seuls les
arbres manquaient au paysage. Pour les anciens Pascuans, un souvenir était
toujours présent dans leur mémoire, c'est celui des noix de coco (niu) dont
se nourrissaient leurs ancêtres, elles figurent parmi les plantes et les
fruits dans un de leur hymne religieux dont voici le vers en question "Atuametua
Ki ai Kiroto Kia Rirituna-rai, Ka pu te niu" (Le dieu ancestral en
s'unissant à l'anguille furieuse produisit la noix de coco). Pour les
polynésiens, le mythe veut qu'un dieu est enfoui en terre une tête
d'anguille qui donna un cocotier.
1722, un dimanche de Pâques, Roggeveen, navigateur hollandais commandant
l'Arena, découvre une île qu'il prit d'abord pour l'île Davis. A mesure
qu'il s'approchait du rivage, il s'aperçut que ce n'était pas l'île décrite
par Davis, car celle ci était habitée. Le contact entre les Pascuans et les
Hollandais eut lieu le lendemain. Un Pascuan venu à la nage, monta à bord,
l'indigène non étonné se montrait curieux, il se promenait sur le pont
contemplait les mats et les canons. Il repartit à la nage comblé de
présents. Le lendemain ils revinrent en nombre sur le navire qu'ils
dévalisèrent. Après ce chapardage, ils repartirent suivis par les
Hollandais. Soudain un ordre cingla "faites feu maintenant" les mousquets
crépitèrent laissant au sol de nombreux Pascuans. Les indigènes s'enfuirent,
les Hollandais rejoignirent leur navire en ayant toutefois aperçu de loin
des monuments étranges. Vue leur taille, ils pensèrent qu'ils étaient en
argile. Pendant cinquante ans cette île fut oubliée. C'est Felipe
Gonzalez y Haedo qui la visita pour la seconde fois en 1770. L'île fut
annexée au royaume espagnol sous le nom de San Carlos. Quatre ans plus tard,
elle reçoit la visite du capitaine Cook. La réception fut identique aux
précédentes visites. C'est grâce au capitaine Cook que l'île a gardé la
renommée qu'elle a encore aujourd'hui, l'explorateur ayant décrit les
statues géantes lors de son voyage. Deux ans plus tard en 1786, le comte de
La Pérouse commandant une expédition française, débarque sur l'île de
Paques. En 1808 un bateau américain mouille au large de l'île de Paques, là
c'est un massacre, les corps jonchent le sol, avant de partir ils enlèvent
douze hommes et dix femmes qu'ils mettent à fond de cale. Arrivés en pleine
mer ils les délivrent. Libres sur le pont du bateau ils sautent tous à l'eau
et nagent pour rejoindre la côte. Les soldats américains essaieront bien de
les reprendre, mais chaque fois qu'ils s'approchaient d'eux ils plongeaient
et disparaissaient. On ne sait s'ils parvinrent à rejoindre le rivage. En
1816 l'île reçut la visite d'un navire russe commandé par le navigateur
Kotzebue. 1838 l'amiral du Petit Thouars mouille au large de l'île. L'année
1862 vit la fin de la civilisation de l'île de Pâques grâce aux négriers
péruviens. C'est l'intervention de Monseigneur Jaussen, qui en 1914 décida
le gouvernement français et l'Angleterre à agir. Sous la pression les
Péruviens relâchèrent les Pascuans qu'ils détenaient pour le ramassage du
Guano, mais il était trop tard. Tous malades atteints de la tuberculose et
de la petite vérole. Seulement une vingtaine parvint sur l'île les autres
étant morts pendant le voyage sur le bateau. L'épidémie gagna les autres
Pascuans restés sur l'île, ainsi disparut la civilisation de l'île de
Pâques. Si l'île de Paques est souvent décrite comme une île désertique,
rocailleuse, volcanique il n'en a pas été toujours ainsi. Roggeveen lui
donna le nom de "paradis terrestre" et La Pérouse fut enchanté par la nature
du site. Les versants des volcans furent et sont encore tapissés de prairies
verdoyantes, les rivages formés de jardins et de bananeraies. Seuls les
arbres manquaient au paysage. Pour les anciens Pascuans, un souvenir était
toujours présent dans leur mémoire, c'est celui des noix de coco (niu) dont
se nourrissaient leurs ancêtres, elles figurent parmi les plantes et les
fruits dans un de leur hymne religieux dont voici le vers en question "Atuametua
Ki ai Kiroto Kia Rirituna-rai, Ka pu te niu" (Le dieu ancestral en
s'unissant à l'anguille furieuse produisit la noix de coco). Pour les
polynésiens, le mythe veut qu'un dieu est enfoui en terre une tête
d'anguille qui donna un cocotier.
![]()