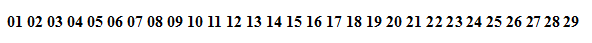Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
Dès 1926, Hitler, dans Mein Kampf, annonçait
les étapes de la politique extérieure du nazisme : réarmement de l'Allemagne
(entrepris dès 1935), formation de la Grande Allemagne par annexion de
l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, conquête de l'espace vital, et destruction
de la puissance militaire française. L'Anschluss de mars 1938, les
revendications allemandes sur la région tchèque des Sudètes, peuplée en grande
partie d'Allemands, auraient dû faire réfléchir les gouvernements occidentaux.
Pourtant ceux-ci préfèrent négocier en signant le traité de Munich (septembre
1938) qui permettait à Hitler d'annexer les Sudètes.
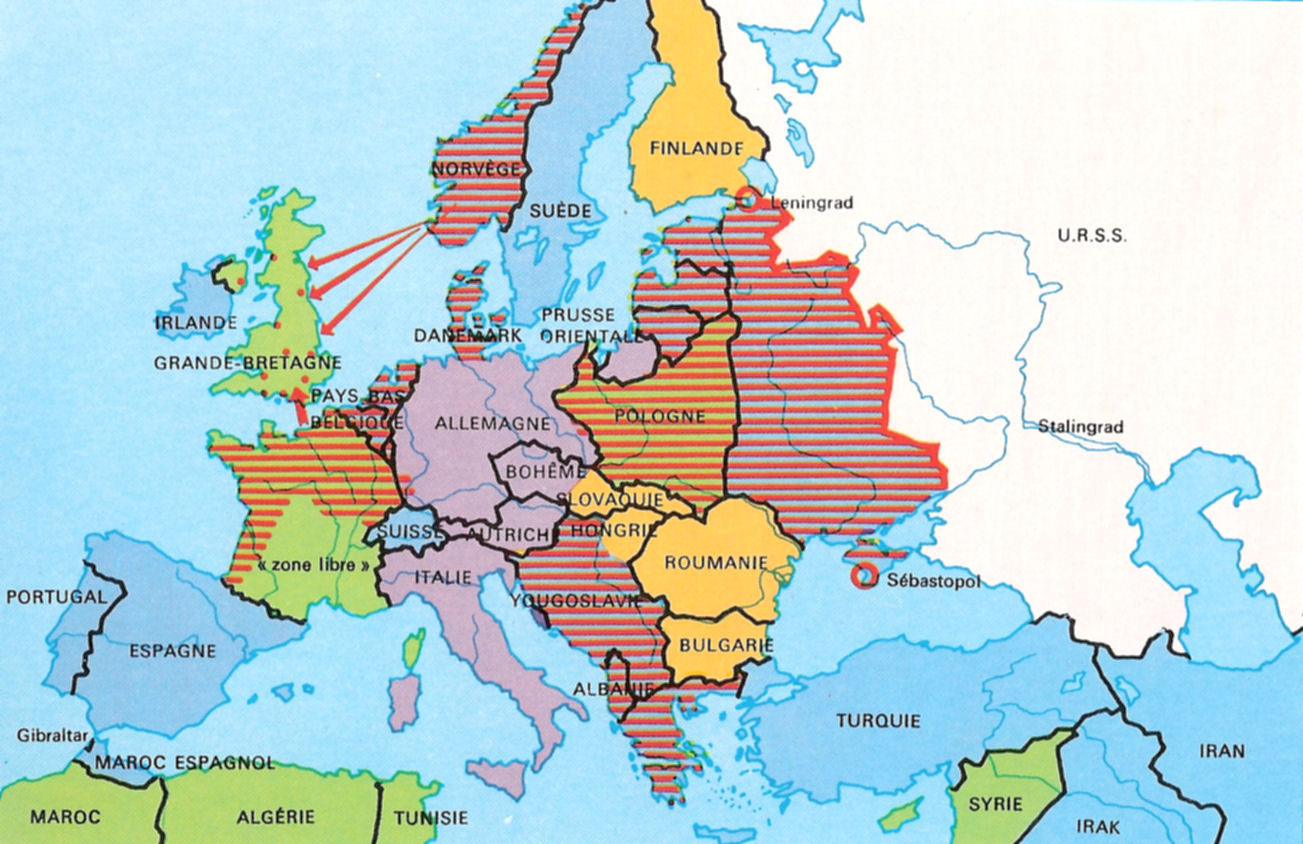 L'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. En noir, les
frontières des Etats au début de 1938. En violet, les pays de l'Axe, en jaune,
leurs alliés, au mois de mars 1939, après l'annexion de l'Autriche et la
création du protectorat allemand de Bohême-Moravie. En rose, la Russie
soviétique, et en bleu, les pays neutres. Les zones hachurées en rouge indiquent
l'expansion extrême des forces de l'Axe avant les contre-offensives des Alliés.
L'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. En noir, les
frontières des Etats au début de 1938. En violet, les pays de l'Axe, en jaune,
leurs alliés, au mois de mars 1939, après l'annexion de l'Autriche et la
création du protectorat allemand de Bohême-Moravie. En rose, la Russie
soviétique, et en bleu, les pays neutres. Les zones hachurées en rouge indiquent
l'expansion extrême des forces de l'Axe avant les contre-offensives des Alliés.
La Grande-Bretagne, dirigée depuis 1937 par Neville
Chamberlain, a prétexté son souci de préserver la paix; mais il faut souligner
que les questions d'Europe centrale ne sont pas essentielles à sa sécurité, et
que la renaissance allemande lui semble nécessaire à l'équilibre des forces en
Europe.
La France doit suivre cette politique britannique pourtant
contraire à ses intérêts : paralysé par une fraction de l'opinion publique
favorable aux régimes autoritaires, conscient du retard militaire d'une armée
pourtant prestigieuse (les divisions blindées sont très réduites malgré les
protestations du général de Gaulle), le gouvernement Daladier préfère renier ses
alliances que de s'engager seul dans un conflit qu'il sent inévitable.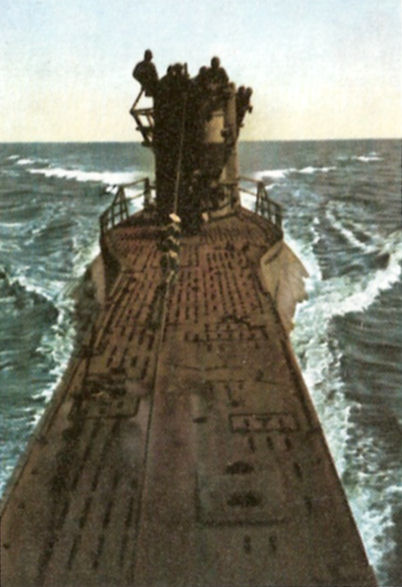
Un sous-marin allemand fait surface pour
se ravitailler. La bataille de l'Atlantique visait à couper la Grande-Bretagne
des Etats-Unis et du Commonwealth. En 1942, dans les convois, les pertes
s'élevèrent à 8 240 000 t.
Les Etats-Unis ayant affirmé leur neutralisme en dépit des
efforts du président Roosevelt, seule l'U.R.S.S. peut soutenir la résistance des
démocraties occidentales face aux visées nazies. Mais la France et la
Grande-Bretagne répugnent à cette alliance, et Staline n'est même pas invité à
la conférence de Munich. Laissée de côté par les Occidentaux, soucieuse de
détourner la menace allemande vers l'ouest pour renforcer son armement,
impatiente aussi de récupérer les territoires abandonnés en 1918, l'U.R.S.S.
signe avec l'Allemagne un pacte de non-agression, dont une clause secrète
prévoit un partage des territoires conquis.
Hitler, qui bénéficie du soutien de Mussolini avec qui il a
signé le "Pacte d'acier", peut donc s'engager plus avant dans sa politique
d'expansion, et lance, le 1er septembre 1939 à 5 heures, sans
déclaration de guerre, les divisions de la Wehrmacht à la conquête de la
Pologne. La Grande-Bretagne, enfin consciente du danger de la surpuissance
allemande, décide d'honorer ses engagements vis-à-vis de la Pologne, et déclare
la guerre à l'Allemagne le 3 septembre à 11 heures; le gouvernement français
fait de même à 17 heures. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale.
 Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes
franchissent la frontière polonaise dont elles brisent ici les barrières. Mais
la Pologne est alliée à la France et à la Grande-Bretagne qui se voient obligées
de déclarer la guerre à l'Allemagne.
Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes
franchissent la frontière polonaise dont elles brisent ici les barrières. Mais
la Pologne est alliée à la France et à la Grande-Bretagne qui se voient obligées
de déclarer la guerre à l'Allemagne.
Ravagée par l'aviation, surprise par la guerre éclair menée
par les divisions blindées allemandes, la Pologne est mise hors de combat en 3
semaines. Après la chute de Varsovie, elle est partagée le 28 septembre entre
l'Allemagne et l'Union Soviétique. Alors qu'à l'ouest l'inaction prédomine dans
une "drôle de guerre", à l'est l'U.R.S.S., pour retrouver ses anciennes
frontières et créer un glacis entre elle et l'Allemagne, occupe l'Estonie, la
Lettonie et la Lituanie, puis envahit la Finlande qui a refusé de lui céder des
bases militaires (30 novembre).
Sur la frontière franco-allemande, les armées ennemies se
font face le long de deux lignes fortifiées : la ligne Maginot et la ligne
Siegfried. Rien ne semblait devoir évoluer, lorsque Hitler prit l'initiative
d'une vaste opération contre le Danemark et la Norvège dont il convoitait les
ressources ferrifères. Le commandant en chef français Gamelin entreprit avec les
Anglais une expédition sur Narvik afin de couper la route du fer vers
l'Allemagne (mai 1940). Mais le succès de cette opération est vite éclipsé par
la fulgurante attaque que les Allemands déclenchent à l'ouest.
Le 10 mai 1940, les troupes de la Wehrmacht se ruent sur la
Hollande et la Belgique. L'armée française se porte à la rencontre des
envahisseurs sans parvenir à stopper leur avance; c'est le moment choisi par
Hitler pour lancer ses divisions blindées à travers les Ardennes, mal défendues
puisque l'état-major les jugeait infranchissables (13 mai). Au lieu de foncer
sur Paris, les "Panzerdivisionen" pivotent vers le nord-ouest et atteignent la
mer le 21 mai. 350 000 Anglais et Français se trouvent encerclés et doivent être
évacués par les navires anglais, depuis Dunkerque.
Un canon antichar allemand en position
de batterie, "quelque part en Europe".
Au sud, le général Weygand, remplaçant Gamelin, ne peut
résister au déferlement allemand. Paris tombe le 14 juin 1940, le 16 juin le
président du Conseil Paul Reynaud démissionne et son successeur, le maréchal
Pétain, héros de la guerre 14-18, demande l'armistice dès le 17 juin. Inquiet
des troubles sociaux qui peuvent résulter de la défaite, le gouvernement accepte
toutes les clauses proposées : les trois quarts du territoire sont occupés, et
l'Allemagne garde près de deux millions de prisonniers français. La France prend
également à sa charge l'entretien des troupes d'occupation. Dans la zone non
occupée, le maréchal et son ministre Pierre Laval réunissent les parlementaires
à Vichy; ceux-ci profitent du désarroi pour mettre fin à la IIIe
République en donnant à Pétain les pleins pouvoirs. A Londres cependant, des
Français refusent la défaite, et le général de Gaulle, par l'appel du 18 juin,
invite tous les militaires à poursuivre la guerre.
La France vaincue, restait l'Angleterre que Hitler croyait
vaincre avec la même rapidité; c'était compter sans la ténacité britannique,
galvanisée avec le Premier ministre Winston Churchill. Le 16 juillet, le Führer
ordonne la préparation du débarquement en Angleterre qui devait être précédée
d'une formidable offensive aérienne qui débute le 8 août. Bien qu'inférieure en
nombre, l'aviation anglaise, aidée par l'usage du radar, parvient à résister et
Hitler doit ajourner le 17 septembre l'ordre de débarquement. Sa nouvelle
tactique va maintenant consister à étouffer l'Angleterre en coupant ses deux
voies de ravitaillement, la Méditerranée et l'Atlantique.
La puissance britannique en Méditerranée s'appuyait sur les
bases de Gibraltar, Malte et Alexandrie. Hitler s'efforce d'obtenir l'appui de
l'Espagne, qui refuse, et de la France. Celle-ci, disposant d'une flotte
importante et intacte, pouvait être un auxiliaire de choix. Devant le danger
d'une collaboration possible entre Hitler et Pétain (rendue probable par
l'entrevue des deux hommes à Montoire), les Anglais exigent de la flotte
française embossée à Mers-el-Kébir qu'elle se joigne à eux ou se mette à l'abri
dans un endroit moins directement menacé. Devant le refus de l'amiral Gensoul,
l'amiral Somerville doit ouvrir le feu : plusieurs navires sont coulés, 1 200
marins sont tués (juillet 1940).
 A la fin de leur campagne contre le Japon, les troupes
américaines plantent leur drapeau sur l'île d'Iwo Shima, base de l'aviation
japonaise (février 1945). L'offensive a coûté 5 000 morts.
A la fin de leur campagne contre le Japon, les troupes
américaines plantent leur drapeau sur l'île d'Iwo Shima, base de l'aviation
japonaise (février 1945). L'offensive a coûté 5 000 morts.
Pour neutraliser Malte, les Italiens entreprennent la
conquête de la Grèce en octobre 1940. Cette campagne se termine par un désastre.
Par crainte de l'installation d'une tête de pont britannique dans les Balkans,
Hitler intervient : après avoir envahi la Yougoslavie, il conquiert la Grèce et
la Crète, gênant considérablement les communications anglaises en Méditerranée
orientale.
Contre Alexandrie et l'influence anglaise au Moyen-Orient,
l'Afrika Korps du maréchal Rommel entreprend des actions vers l'Egypte à partie
de la Libye, pendant que la Wehrmacht profite des aérodromes et des ports
français du Levant, prêtés par l'amiral Darlan, pour tenter de s'implanter dans
la région. Les Anglais réagissent en occupant l'Irak, la Syrie et le Liban
(mars-juillet 1941).
Dans l'Atlantique, les submersibles allemands s'efforcent de
détruire les convois de ravitaillement en provenance des Etats-Unis. Jusqu'en
novembre 1940, Roosevelt ne put adopter une attitude franchement
interventionniste face à une opinion publique isolationniste qui se serait
opposée à sa réélection. De nouveau président, il peut, dès mars 1941, faire
adopter la loi du prêt-bail qui autorise des livraisons de matériel sous forme
de prêts et non pas avec paiement comptant. Le 14 août 1941, il élabore avec
Churchill un projet de reconstruction du monde de l'après-guerre selon des
principes démocratiques (charte de l'Atlantique). C'est démentir directement la
valeur des idéologies autoritaires nazie et fasciste.
Les victoires de l'Axe sont donc fragiles puisque
l'Angleterre n'est pas écrasée et que les Etats-Unis s'engagent de plus en plus
dans le conflit. C'est pourtant à ce moment que Hitler décide de se débarrasser
de l'U.R.S.S., allié devenu rival depuis les conquêtes soviétiques sur la
Baltique et la poussée allemande dans les Balkans.
Le plan Barbarossa, prévoyant l'écrasement rapide de
la Russie, est déclenché le 22 juin 1941, avec plus d'un mois de retard sur
l'horaire prévu, du fait de la nécessaire intervention en Grèce. Ce contretemps
allait être fatal à l'Allemagne. Trois millions d'hommes appuyés par 10 000
chars et 3 000 avions foncent dans trois directions : au nord, le maréchal von
Leeb parvient aux portes de Leningrad; au centre, le maréchal von Bock arrive à
20 km de Moscou; au sud, le maréchal von Rundstedt remporte d'éclatants succès
qui le mènent sur les bords de la mer d'Azov après la prise de Kiev. L'U.R.S.S.
semblait sur le point de tomber sous la domination nazie quand l'hiver survint,
stoppant les Allemands par -25°C et les contraignant même à se retirer à 200 km
de Moscou. La guerre éclair avait échoué; le conflit s'enlisait au moment où il
atteignait une dimension mondiale par l'entrée en guerre du Japon et des
Etats-Unis.
Les Trois Grands, à la
conférence de Yalta, en février 1945, se partagent les zones d'influence dans le
monde. La victoire des Alliés était déjà assurée lorsque Churchill, Roosevelt et
Staline se réunirent au bord de la mer Noire, pour coordonner leur action finale
contre l'Allemagne et organiser l'Europe libérée. Roosevelt y obtint de Staline
qu'il déclarât la guerre au Japon.
Les visées expansionnistes des Japonais dans le Sud-Est
asiatique, mettant à profit les difficultés des Occidentaux et notamment de la
France, se heurtaient aux ambitions des Américains. Le conflit était inévitable,
et la destruction sans déclaration de guerre de la flotte américaine du
Pacifique, dans la rade de Pearl Harbour, le 7 décembre 1941, conduit Roosevelt
à entrer dans le conflit. Le 11 décembre, l'Allemagne et l'Italie, au nom du
pacte tripartite signé avec le Japon, lui déclarent la guerre. La rapide
conquête des îles de Guam et Wake, le débarquement aux Philippines et
l'occupation de toute l'Indonésie, assurent au Japon la maîtrise de tout le
Pacifique occidental. Pour riposter, les Etats-Unis devaient attendre de
reconstituer leur potentiel militaire, en partie détruit le 7 décembre.
L'Axe était victorieux partout mais n'avait remporté aucun
des succès décisifs qu'il escomptait. Trop impatient de dominer le monde, il
avait uni contre lui l'U.R.S.S., les Etats-Unis et la Grande-Bretagne; désormais
le temps jouait contre lui.
Afin d'éviter ce péril, l'Allemagne reprenait l'offensive dès
le début de l'été 1942. Après avoir franchi le Don, la Wehrmacht se dirigeait
vers la basse Volga et le Caucase pour couper l'armée Rouge de ses sources de
ravitaillement en pétrole. La Volga est atteinte à Stalingrad à la fin du mois
d'août, mais la ville se transforme en véritable camp retranché qui parvient à
résister sous un déluge de feu. En novembre, 150 divisions et 5 000 chars russes
entreprennent de dégager la ville; malgré la menace d'encerclement, Hitler
ordonne à ses troupes de résister. Une terrible bataille s'engage dans les
décombres; le 31 janvier 1943, le maréchal von Paulus se rend après avoir perdu
250 000 hommes. Première grande défaite allemande de la guerre, Stalingrad
allait permettre à l'armée Rouge de reprendre l'offensive.
En Méditerranée, la situation anglaise était inquiétante,
mais la victoire du général Montgomery à El-Alamein, face aux blindés de Rommel,
stoppait l'avancée allemande sur l'Egypte et obligeait l'ennemi à se replier sur
la Libye (novembre 1942). Le général Eisenhower lance alors plus de 100 000
hommes à la conquête de l'Afrique du Nord grâce aux débarquement du 8 au 10
novembre 1942 à Casablanca, Oran et Alger. La résistance française au
débarquement, de courte durée, n'empêche pas Hitler d'envahir la zone non
occupée pour prévenir une éventuelle attaque alliée par le sud. Le 12 novembre
il occupe la Tunisie qu'il essaie de préserver de l'avance anglo-américaine,
avec l'aide des blindés du maréchal Rommel repliés de Libye. C'était compter
sans la détermination alliée qui contraignit les Allemands à rembarquer en mars
1943.
La suprématie de l'Axe était également contestée dans le
Pacifique où la flotte américaine reconstituée par l'amiral Nimitz remporta deux
grands succès dans la mer de Corail et dans l'archipel des Midways. L'avance
nippone était elle aussi stoppée.
Les difficultés militaires, l'échec de la guerre éclair,
amènent le Führer à accentuer sa pression sur les pays occupés, comme la France.
Augmentant les frais d'entretien des armées d'occupation, profitant de la bonne
volonté des collaborateurs du maréchal Pétain, P. Laval et l'amiral Darlan, pour
s'octroyer une large part de la production nationale et pour recruter à peu de
frais une nombreuse main-d'œuvre aussitôt envoyée en Allemagne, il rend de plus
en plus oppressante la présence allemande.
Face à elle, la résistance s'organise : en France, elle
entrave la bonne marche de l'administration vichyssoise et allemande, créant
même des maquis dans le Vercors, le Massif central et les Pyrénées. Des groupes
plus secrets organisent sabotages et attentats, publient des journaux dénonçant
la répression allemande et les "collaborateurs" français.
Depuis juin 1940, le général de Gaulle affirme la nécessité
de maintenir la France dans la guerre; avec l'aide financière des Anglais, il
peut faire participer les troupes de la France libre, conduites par le général
Leclerc, aux opérations alliées en Afrique du Nord. Il parvient également à
réunifier la résistance intérieure en envoyant Jean Moulin qui organise en mai
1942 le Conseil national de la Résistance (C.N.R.). Le prestige du chef de la
France libre s'étend de plus en plus : il devient seul maître du Comité français
de Libération nationale fondé à Alger, transformé en 1944 en gouvernement
provisoire de la République française.
D'autres pays européens connurent aussi une résistance très
active : en Yougoslavie par exemple, Tito parvint, avec le soutien financier
russe, à débarrasser son pays de l'occupant, malgré l'intense activité de la
Gestapo et Waffen SS chargés de lutter contre les maquis.
Ces résistances intérieures, conjuguées avec les difficultés
rencontrées sur tous les autres fronts, contribuèrent à rompre définitivement
l'équilibre des forces ennemies.
L'U.R.S.S. et les Etats-Unis consacrent tous leurs efforts à
accroître un matériel de guerre qui devient très supérieur à celui des
Allemands. Dès lors, la défaite du Reich paraît inévitable. Les côtes d'Afrique
sont utilisées comme point de départ d'un débarquement en Sicile en juillet
1943. Le 24 juillet, Mussolini doit démissionner, et l'armistice est signé le 3
septembre. Mais les Allemands sont déjà fortement installés dans la péninsule,
et la progression des Alliés en est considérablement freinée, malgré les
héroïques percées du général Juin à Cassino. Ce demi-échec rend nécessaire
l'ouverture d'un deuxième front qui doit également soulager les Russes, déjà
parvenus à libérer une grand partie de leur territoire.
La conférence de Téhéran (novembre 1943) entre Staline,
Roosevelt et Churchill, retient le principe d'un débarquement en France.
Organisé par Eisenhower, il a lieu dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 en Basse
Normandie. 5 000 bateaux amènent sur le sol français les hommes et le matériel
nécessaires à une rapide reconquête du pays. La progression vers l'est est
favorisée par un autre débarquement, sur les côtes de Provence. Menacés
d'encerclement, les Allemands se replient vers le nord-est. En décembre, la
France et la Belgique sont libérées. Le 25 août, le général de Gaulle fait son
entrée à Paris et constitue un gouvernement.
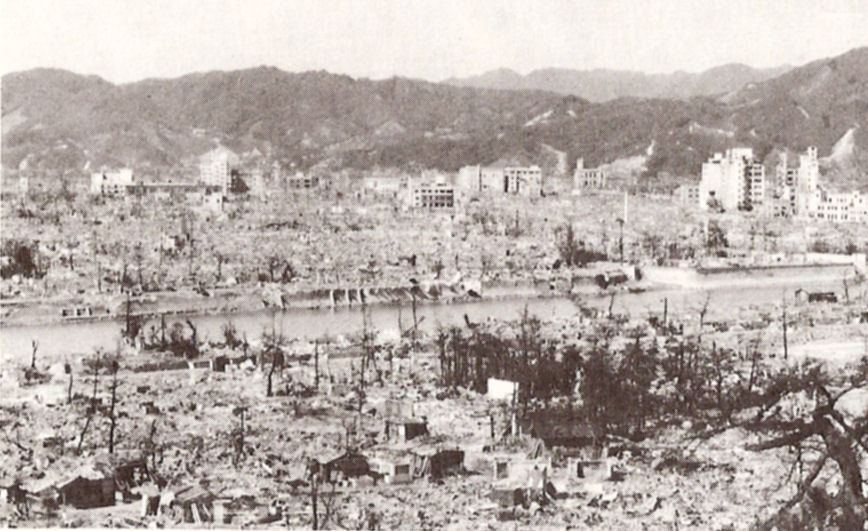 Le 6 août 1945, la bombe atomique écrase Hiroshima: 160 000
morts. Après Nagasaki, (9 août, 40 000 morts), le Japon capitule. Les Américains
prévoyaient sinon une offensive de 18 mois et 1 million de morts.
Le 6 août 1945, la bombe atomique écrase Hiroshima: 160 000
morts. Après Nagasaki, (9 août, 40 000 morts), le Japon capitule. Les Américains
prévoyaient sinon une offensive de 18 mois et 1 million de morts.
Sur le front est, le recul allemand se précipite; tout le
territoire russe est libéré; la Finlande, la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie
doivent céder devant la progression de l'armée Rouge. Redoutant d'être
encerclés, les Allemands évacuent la Grèce, aussitôt occupée par les Anglais.
Battue sur tous les fronts, l'Allemagne se trouve presque
entièrement encerclée, tandis que des bombardements aériens incessants dévastent
ses villes et ses campagnes. Seul, Hitler croit encore à la victoire et envoie
de nouveaux engins de guerre (missiles V1 et V2) sur l'Angleterre. La terreur
s'installe en Allemagne même, à la suite de l'attentat manqué contre le Führer
en juillet 1944.
En février 1945, Churchill, Roosevelt et Staline se
rencontrent à Yalta et décident de lancer une offensive parallèle. Les Russes
envahissent Berlin en avril, après des combats acharnés qui ne s'achèvent que le
2 mai avec le suicide de Hitler, puis font leur jonction avec les Américains
dans les environs de Leipzig. Le 7 mai, le gouvernement allemand signe à Reims
une capitulation sans conditions. A la fin du moi d'avril, Mussolini avait lui
aussi connu une fin lamentable : arrêté par les résistants, il fut exécuté et
pendu par les pieds.
La situation était plus indécise dans le Pacifique où les
Japonais opposaient une farouche résistance. Utilisant la tactique du "saut de
mouton", les Américains n'attaquent que les bases stratégiques indispensables,
par bonds successifs. Ils parviennent ainsi à reconquérir les Philippines en
février 1945, puis s'installent dans les îles d'Iwo Shima et d'Okinawa à partir
desquelles ils peuvent bombarder le Japon. Celui-ci résiste de plus en plus
difficilement aux attaques anglaises en Birmanie et aux offensives chinoises.
Mais il dispose encore de forces considérables sur son territoire même, et c'est
pour en finir que le président américain Truman, successeur de Roosevelt, décide
d'utiliser des bombes atomiques : à Hiroshima le 6 août 1945, et à Nagasaki le
9, l'atome fait ses premières victimes, plusieurs centaines de milliers. Le 2
septembre, le Japon capitulait sans conditions.
La guerre était finie, ayant fait plus de 40 millions de
victimes; une sorte de partage du monde s'opérait entre les vainqueurs, rendant
inévitables des heurts nouveaux. Alliés par suite de nécessités Américains et
Russes sont conscients de leurs profondes divergences, et la victoire à peine
acquise, le monde se trouve de nouveau divisé. La formation de deux blocs
antagonistes impose l'appartenance de tous les pays à l'une des zones
d'influence : entre 1945 et 1948, les pays d'Europe centrale et orientale se
transforment en démocraties populaires dépendantes de l'Union soviétique; en
face, l'Europe occidentale tombe dans l'orbite américaine.